
adjectif
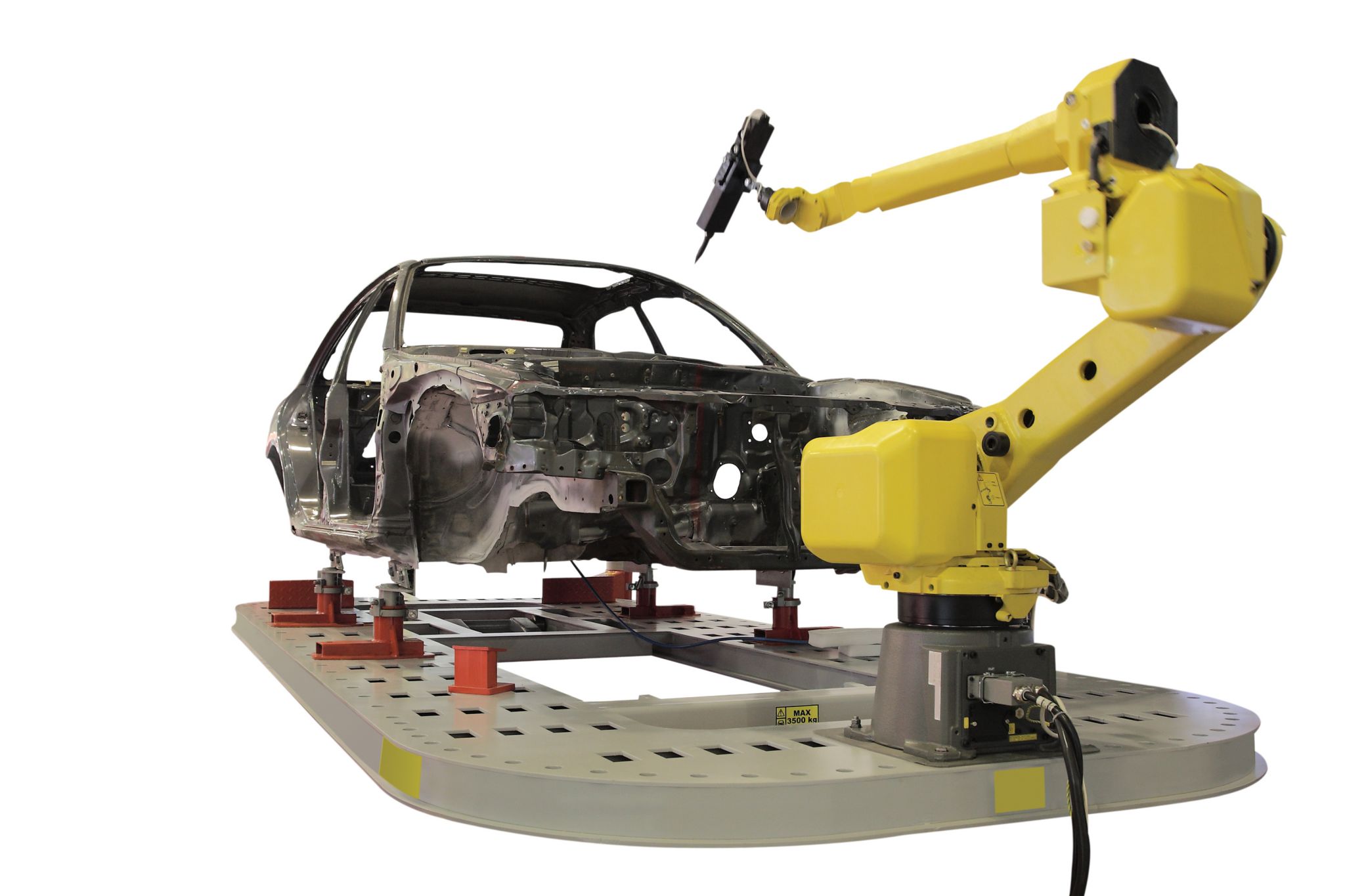
La première révolution industrielle
Les conditions de la première révolution industrielle. L'industrialisation est le résultat d'une interaction entre différents facteurs : la croissance démographique de l'Europe à partir du XVIIIe s. ; les progrès de l'agriculture grâce à la généralisation des cultures fourragères, qui permettent d'éviter la jachère ; l'amélioration des voies de communication (canaux, routes) ; les progrès techniques à l'origine de la mécanisation de la production. Le développement du machinisme suppose, en outre, l'accumulation de capitaux : les entrepreneurs peuvent emprunter auprès des banques qui connaissent un important développement. Ces transformations sont elles-mêmes liées au rôle de l'État, qui préserve la liberté d'entreprendre et garantit la monnaie.
Les progrès techniques. Dès la fin du XVIIIe s., en Grande-Bretagne, diverses inventions permettent la mécanisation de la filature, puis du tissage, principalement du coton. La métallurgie prend son essor avec la découverte du procédé de la fonte au coke, qui évite de recourir au charbon. Mais l'invention décisive est celle de la machine à vapeur, mise au point par Watt entre 1760 et 1785. Source d'énergie capable de mettre en mouvement les machines, la vapeur est à l'origine, dans la première moitié du XIXe s., de l'essor de la production de charbon. L'apparition de la locomotive, mise au point par Stephenson en 1815, entraîne la construction de vastes réseaux de chemin de fer, dont les premières lignes apparaissent dans les années 1830.
Une industrialisation inégale. Elle a été marquée par des phases d'expansion, interrompues par des crises économiques, et n'a pas touché tous les pays à la même époque. La Grande-Bretagne connaît ainsi un démarrage précoce au XVIIIe s., qui lui permet de devancer très largement, jusque dans le dernier quart du XIXe s., les autres nations industrialisées. En France, la grande période d'industrialisation correspond à la monarchie de Juillet et au second Empire. En Allemagne, l'essor industriel date principalement de la seconde moitié du XIXe s., ainsi qu'en Autriche-Hongrie, où le développement économique reste cependant limité à certaines régions (Bohême). L'Europe méditerranéenne et orientale ne connaît, quant à elle, qu'une industrialisation marginale. En dehors de l'Europe, seuls les États-Unis seront touchés, dans la seconde moitié du XIXe s., par la première révolution industrielle.
Les conséquences de l'essor industriel. Cette première révolution s'est traduite par un formidable essor de la production industrielle et des usines, par un accroissement considérable de la population urbaine (alimentée par l'exode rural), par la concentration des activités industrielles, notamment près des gisements de matières premières. Les échanges commerciaux, intérieurs et internationaux, s'intensifient grâce à la construction d'un réseau de canaux européens, à l'ouverture du canal de Suez (1869). Par ailleurs, cette industrialisation s'est faite en exploitant une masse importante de main-d'œuvre marquée par le déracinement et dont les conditions de vie, très rudes, ne s'amélioreront que très progressivement au cours du siècle.
La deuxième révolution industrielle.
Elle repose sur l'utilisation de nouvelles sources d'énergie : l'électricité, dont l'usage commence à se répandre dans les années 1880, le gaz et le pétrole (dont l'emploi est rendu possible par la mise au point du moteur à explosion à la fin du siècle). L'acier l'emporte sur le fer tandis que se développe la chimie de synthèse, productrice de colorants, de textiles artificiels et d'engrais. De nouvelles inventions transforment la vie quotidienne (bicyclette, téléphone, lampe à incandescence d'Edison). Puis l'automobile et l'avion révolutionnent les moyens de transport au début du XXe s. Cette deuxième révolution industrielle est marquée par la concentration des entreprises et par l'accroissement du rôle joué par la recherche et les capitaux. Elle coïncide également avec l'impérialisme colonial.