
nom féminin
(de 2. mécanique)
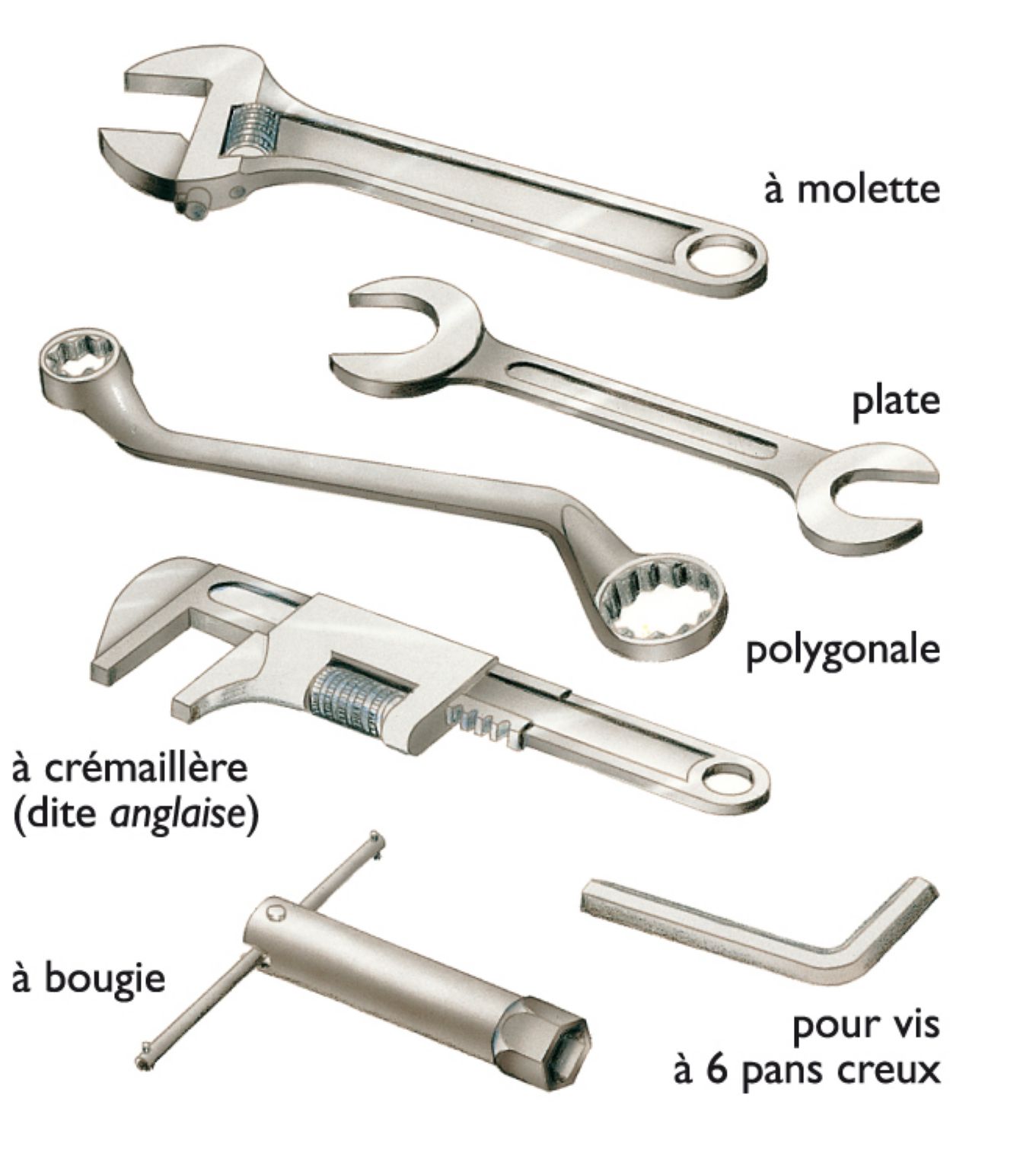
Mécanique classique.
La mécanique classique comprend trois branches principales : la statique, la dynamique et la cinématique. Son histoire remonte aux travaux d'Archimède sur la statique et l'hydrostatique, essayant d'expliquer l'équilibre des objets solides et des liquides. Beaucoup plus récente, la dynamique n'a guère commencé qu'avec Galilée, qui, le premier, énonce le principe de relativité. Mais son véritable acte de naissance est constitué par les Principes mathématiques de philosophie naturelle (1687) de Newton, qui en posent les fondements et en dégagent les applications aux mouvements des corps célestes. Il énonce trois principes fondamentaux : principe d'inertie (un objet isolé garde son mouvement indéfiniment) ; égalité des valeurs d'une action et de la réaction qui lui est opposée ; égalité entre la somme des forces agissant sur un objet et le produit de sa masse par son accélération.
Au XVIIIe s., Euler, d'Alembert, Clairaut et Lagrange – qui systématise tous les travaux de ses précurseurs dans sa Mécanique analytique (1788) – font des théories de Newton le modèle de la science théorique. Après son Exposition du système du monde (1796), Laplace réunit dans sa Mécanique céleste (1798-1825) tous les travaux, jusque-là épars, de Newton, de Halley et d'Euler sur les conséquences du principe de la gravitation universelle.
La fin du XIXe s. voit l'approfondissement des principes de la mécanique (Hertz, Mach) et l'avènement de la mécanique statistique (Boltzmann, Gibbs), étroitement liée à la thermodynamique.
Mécanique relativiste.
Au début du XXe s., la mécanique se présente comme un tout cohérent, mais ses bases ont été minées par l'évolution de l'ensemble de la science. Einstein révise les lois de la physique en s'appuyant sur le principe de relativité (les lois physiques sont les mêmes pour deux systèmes de référence animés l'un par rapport à l'autre d'une translation uniforme) et en y ajoutant celui de la constance de la vitesse de la lumière. La théorie de la relativité restreinte aboutit ensuite à celle de la relativité générale, largement vérifiée par l'expérience. La mécanique classique newtonienne conserve une approximation suffisante lorsque les vitesses sont négligeables par rapport à celle de la lumière.
Mécanique ondulatoire, mécanique quantique.
La mécanique newtonienne, qui convient au mouvement des corps de dimensions macroscopiques, ne peut pas s'appliquer à celui des particules élémentaires. En 1924, L. de Broglie a été conduit à associer au mouvement d'une particule la propagation d'une onde. Cette mécanique ondulatoire a reçu une éclatante confirmation expérimentale avec la découverte, en 1927, de la diffraction des électrons par une lame cristalline, tandis que Schrödinger a montré son équivalence avec la mécanique quantique, développée principalement par Heisenberg.