


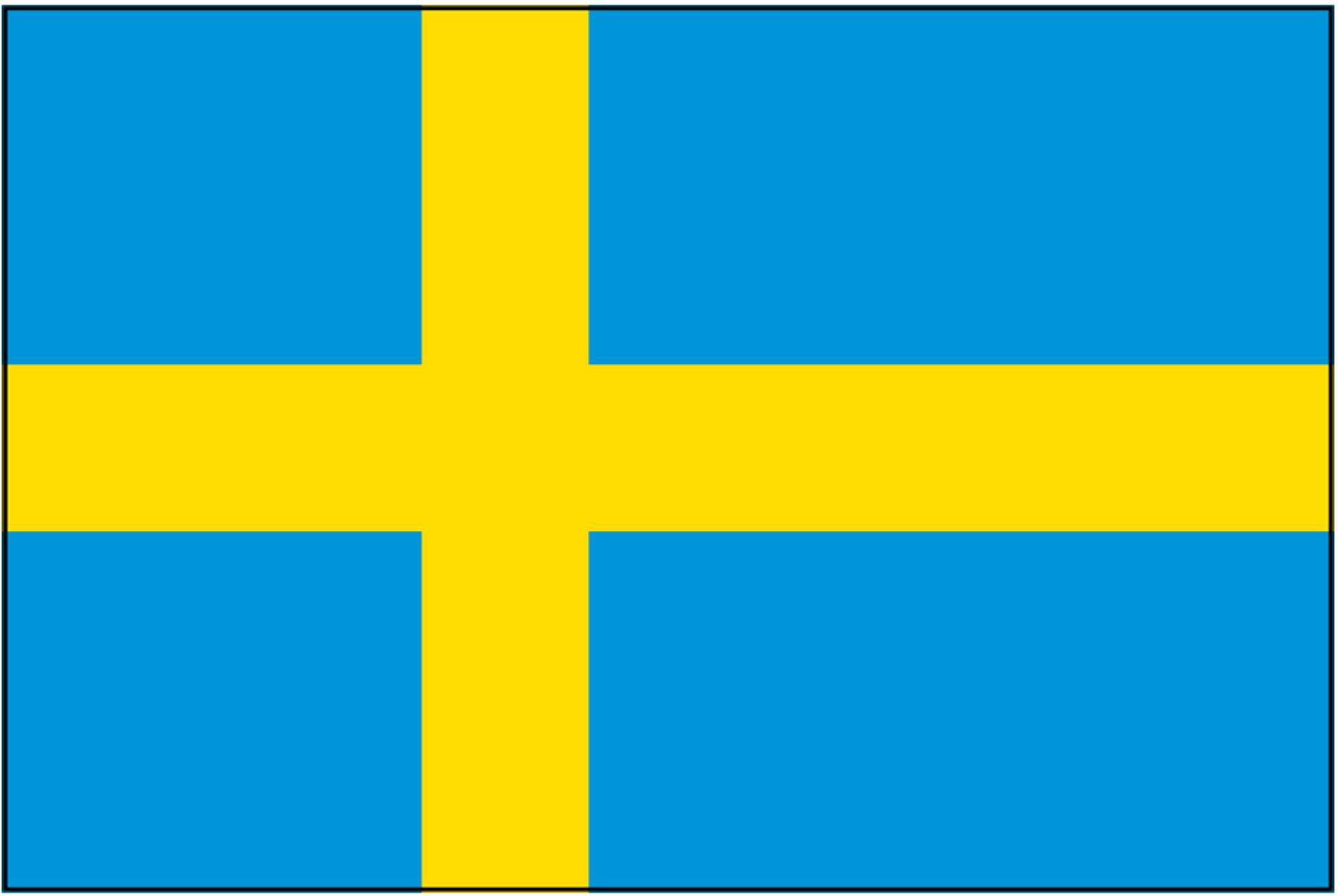




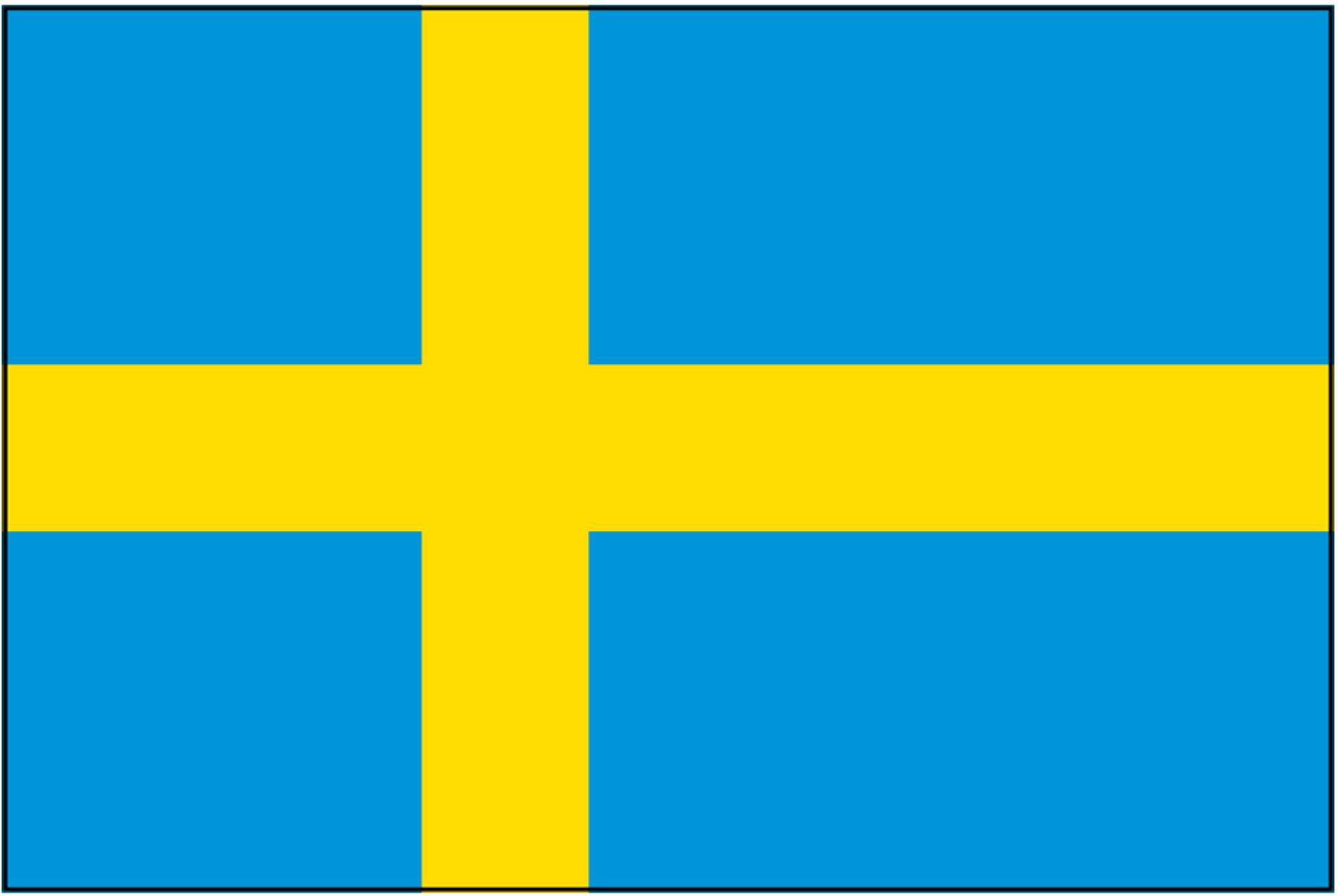


GÉOGRAPHIE
Les conditions naturelles. Les altitudes décroissent de la frontière norvégienne au golfe de Botnie, bordé de basses plaines littorales. De nombreux fleuves coulent vers la Baltique ; leurs hautes vallées, barrées par des moraines, ont formé des lacs, utilisés par l'hydroélectricité. Le Norrland occupe près de la moitié nord du pays ; presque vide, il a des ressources naturelles (bois, mines) et une vocation touristique. La Suède centrale correspond à une dépression traversée par la ligne de partage des eaux entre le Skagerrak et la Baltique. Dominée par les deux plus grandes villes, Göteborg et Stockholm, cette région a été le premier foyer industriel du pays et a également de bonnes capacités agricoles. La partie méridionale est bordée par les îles Gotland et Öland, les forêts y alternent avec les zones agricoles, et elle ouvre les communications, avec le Danemark, par Malmö et Hälsingborg et, avec l'Allemagne, par Trälleborg.
Dans le Nord, les températures moyennes de février varient entre − 6 °C et − 12,5 °C, tandis que, plus au sud, les perturbations venues de la mer de Norvège adoucissent le climat. Néanmoins, la majorité des précipitations tombent durant l'été. La forêt, de pins et de sapins (les feuillus ne poussant que dans le Sud), couvre plus de 50 % du territoire.
La population et l'économie. La population, urbanisée à 86 %, est concentrée dans le tiers sud du pays. Son accroissement naturel est infime et son vieillissement s'accentue. Dans des conditions naturelles difficiles, l'agriculture utilise environ 7 % de la superficie du pays, emploie 2 % de la population active et satisfait la plus grande partie des besoins du pays. L'élevage, bovin (surtout laitier) et porcin, repose en grande partie sur les céréales : orge, avoine et blé. La betterave à sucre, les oléagineux, les légumes sont les autres productions notables auxquelles s'ajoutent les revenus de la pêche.
L'exploitation forestière, ancienne, a été restructurée. Les parts de l'hydroélectricité et du nucléaire sont prépondérantes dans la production électrique. La principale ressource minière est le fer, dont la production est en baisse. Le secteur industriel emploie environ 18 % de la population active. Si certaines branches traditionnelles ont reculé (chantiers navals, acier, textiles), les secteurs à haute technologie se sont développés, en particulier l'électroménager, l'automobile, la robotique, l'électronique et les télécommunications. En raison de l'étroitesse du marché intérieur, plus de la moitié de la production industrielle est exportée.
La Suède se situe parmi les premiers pays du monde pour le produit par habitant. Ses échanges se font pour plus de la moitié avec les pays de l'Union européenne.
HISTOIRE
Les origines. Peuplée dès le néolithique, la Suède établit au IIe millénaire des relations avec les pays méditerranéens. Aux IXe et XIe s., tandis que les Danois et les Norvégiens écument l'Ouest européen, les Suédois, connus sous le nom de Varègues, commercent avec les pays de la mer Noire et de la Caspienne. La christianisation du pays progresse après le baptême du roi Olof Skötkonung (1008).
Formation de la nation suédoise. L'extinction de la dynastie crée une anarchie politique qui dure jusqu'en 1222 et favorise l'émancipation de l'Église. Celle-ci, qui obtient d'importants privilèges, pousse Erik IX le Saint (1156-1160) à entreprendre une croisade contre les Finnois païens, prélude à la conquête de la Finlande (1157).
1164. Création de l'archevêché d'Uppsala, qui devient la capitale religieuse de la Suède.
1250. Birger Jarl fonde la dynastie des Folkung et établit sa capitale à Stockholm.
Les institutions féodales sont établies dans le pays. La monarchie s'affaiblit au profit de la noblesse, tandis que la Hanse, à partir de Visby, renforce son rôle commercial.
1319-1363. La dynastie des Folkung unit la Suède et la Norvège.
Mais la peste de 1346, la sécession de la Norvège, la mainmise de Lübeck sur le commerce et les luttes dynastiques affaiblissent le pays, dont s'empare Marguerite, régente de la Norvège et du Danemark, en 1389.
1397. Par l'Union de Kalmar, son héritier, Erik de Poméranie, reçoit les trois couronnes.
L'opposition nationale suédoise crée une régence, confiée à partir de 1470 à la famille des Sture. En 1520, Christian II de Danemark triomphe de cette opposition, mais le « bain de sang de Stockholm » suscite un soulèvement général dirigé par Gustave Ier Vasa.
L'époque de la Réforme
1523-1560. Élu roi, Gustave Ier Vasa supprime les privilèges commerciaux de la Hanse et fait reconnaître l'hérédité de la Couronne (1544) ; le luthéranisme devient religion d'État.
Son successeur, Erik XIV, tente de contrôler le commerce russe, mais, battu au cours d'une guerre de sept ans (1563-1570), il est déposé par la noblesse au profit de son frère Jean III, qui continue une politique de conquête à l'est. Sigismond Vasa, roi de Pologne, qui veut rétablir le catholicisme, est évincé à son tour.
La période de grandeur
1611-1632. Gustave II Adolphe pose les bases de la puissance suédoise.
Il réorganise les institutions et l'armée, développe l'économie (mines et métallurgie), poursuit la conquête de la côte baltique russe, puis occupe la Prusse polonaise et intervient victorieusement dans la guerre de Trente Ans. Le régent Oxenstierna, puis la reine Christine (1632-1654) poursuivent la même politique, et la Suède obtient le contrôle de la Baltique après les traités de Brömsebro (1645), Westphalie (1648) et Roskilde (1658).
1697-1718. Charles XII gouverne en souverain absolu. Entraîné dans la guerre du Nord (1700-1721), le roi épuise son pays dans de coûteuses campagnes.
L'ère de la liberté et l'épopée gustavienne. Au XVIIIe s., sous l'influence des idées nouvelles, l'économie se développe et la vie culturelle atteint son apogée avec Celsius, Linné, Swedenborg. Le Parlement (Riksdag), contrôlé par la noblesse, s'empare du pouvoir. La victoire du parti des Chapeaux, soutenu par la France, sur le parti pacifiste des Bonnets entraîne la Suède dans la guerre de Sept Ans et dans une guerre contre la Russie, qui lui fait perdre le sud-est de la Finlande.
1771-1792. Gustave III restaure l'absolutisme.
1808. Gustave IV Adolphe perd la Finlande et est renversé en 1809.
1809-1818. Charles XIII poursuit la politique antifrançaise de Gustave IV Adolphe et adopte (1810) comme successeur le maréchal français Bernadotte, qui s'allie (1812) avec l'Angleterre et la Russie contre Napoléon.
L'union avec la Norvège
1814. Par le traité de Kiel, la Norvège est unie à la Suède.
1818-1844. Roi sous le nom de Charles XIV, Bernadotte mène une politique absolutiste et doit accepter des réformes libérales en 1840.
L'évolution libérale se poursuit pendant tout le XIXe s., en même temps que la modernisation économique du pays, accélérée par l'adoption du libre-échange (1888). Le développement de l'industrie, s'il favorise l'apparition du parti social-démocrate (1889), ne peut absorber l'excédent de population rurale, qui émigre vers les États-Unis.
1905. La Norvège se sépare de la Suède.
La démocratie moderne. Sous le règne de Gustave V (1907-1950), la Suède connaît une période de prospérité économique sans précédent et conserve sa neutralité durant les deux guerres mondiales. Les progrès de la social-démocratie entraînent l'adoption du suffrage universel (1907) et des réformes sociales (assurance vieillesse, journée de huit heures, vote des femmes) qui s'amplifient à partir de 1920 (premier gouvernement social-démocrate, dirigé par Branting). Monarchie constitutionnelle, la Suède est, de 1932 à 1976, gouvernée sans interruption par le parti social-démocrate.
1976-1982. Gouvernements conservateurs.
1982. Retour des sociaux-démocrates au pouvoir, avec Olof Palme.
1986. Olof Palme est assassiné. Le social-démocrate Ingvar Carlsson lui succède au poste de Premier ministre.
1991. Le conservateur Carl Bildt devient Premier ministre.
1994. I. Carlsson revient à la tête du gouvernement.
1995. La Suède adhère à l'Union européenne.
1996. I. Carlsson démissionne. Göran Persson lui succède à la tête du parti social-démocrate et du gouvernement.
2006. Les conservateurs, conduits par Fredrik Reinfeldt, reviennent au pouvoir.
2010. Pour la première fois, l'extrême droite entre au Parlement. Arrivés en tête des élections, les conservateurs forment un gouvernement minoritaire.
2014. Après une courte victoire, le social-démocrate Stefan Löfven forme un gouvernement minoritaire avec les Verts.
2021. Après la démission de S. Löfven, Magdalena Andersson prend la tête des sociaux-démocrates et du gouvernement.
2022. Les partis de droite remportent les élections législatives. Le conservateur Ulf Kristersson devient Premier ministre.
2024. La Suède adhère à l'OTAN.