


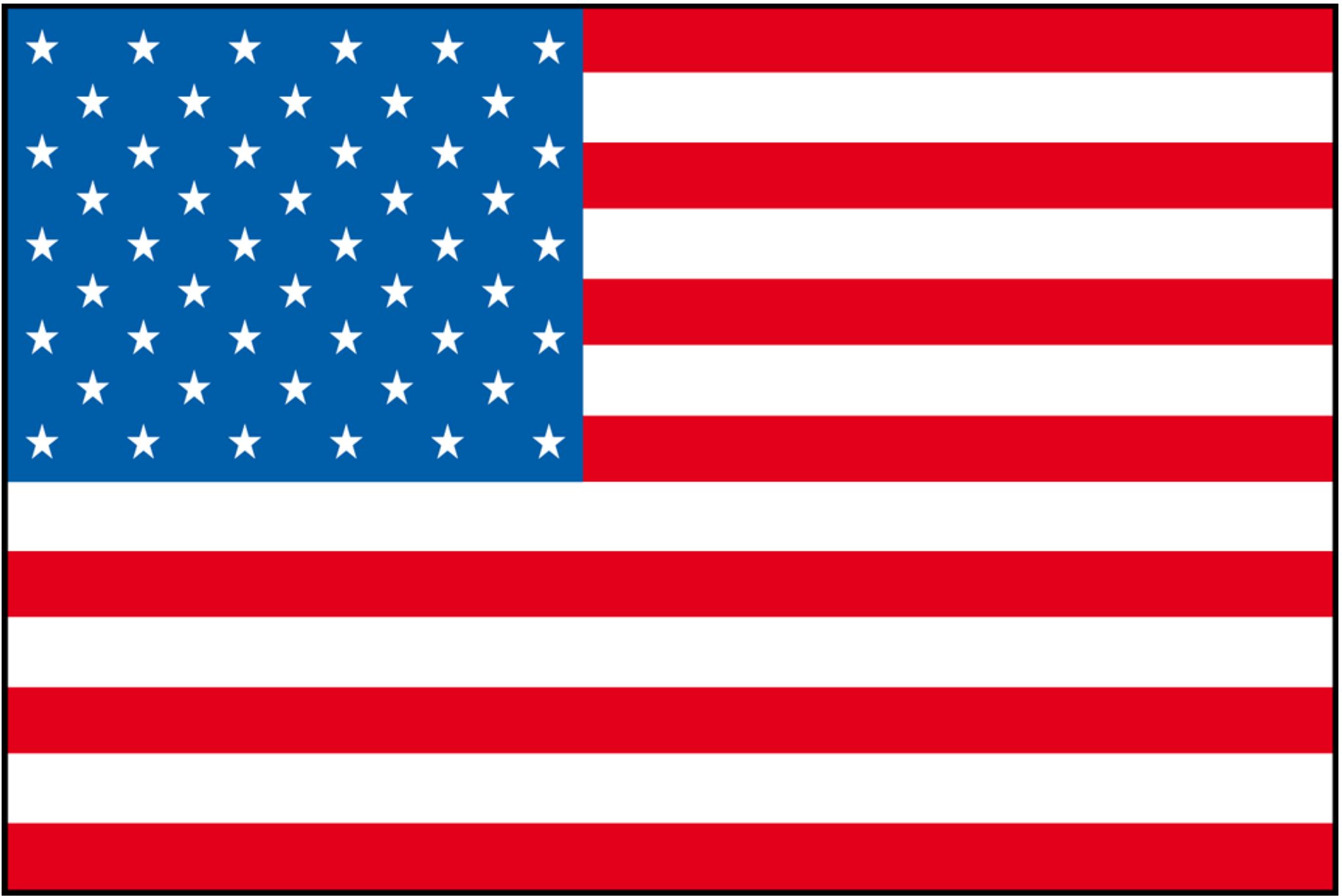






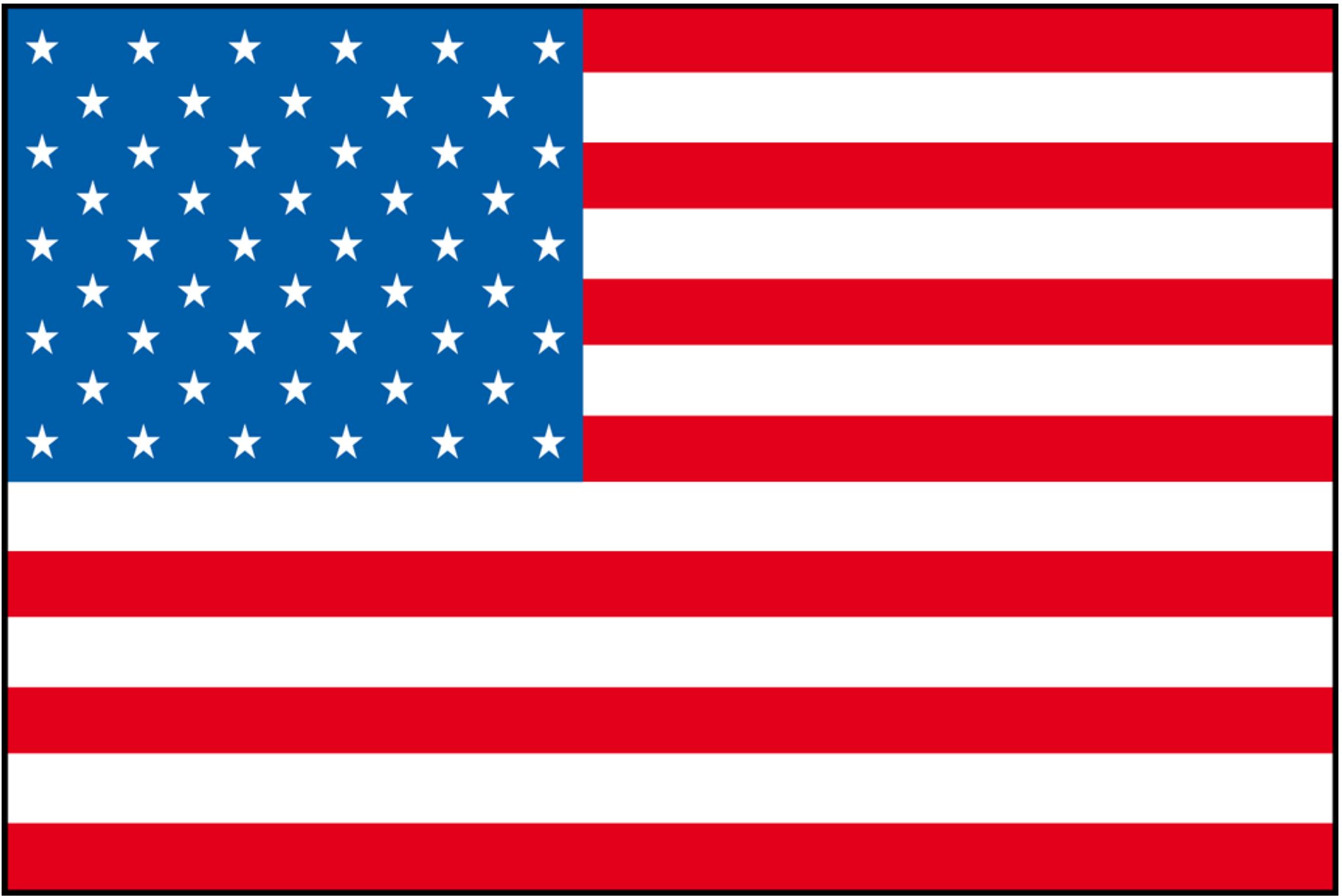




GÉOGRAPHIE
Les États-Unis viennent au troisième rang mondial pour la population, au quatrième pour la superficie. Le territoire, s'étendant sur 4 000 km d'O. en E. (quatre fuseaux horaires) et plus de 2 500 km (25o de latitude) du N. au S., est le support de la première économie mondiale.
Le milieu naturel. Les types de paysages sont à l'échelle d'un continent. À l'O., le système des Rocheuses occupe une superficie égale à cinq fois celle de la France. Il est formé de séries de chaînes N.-S., dominant de hauts plateaux ou bassins intérieurs. C'est, en retrait d'une plaine pacifique, étroite et discontinue, une barrière climatique, réduisant surtout les précipitations vers l'E., vers les Grandes Plaines. Celles-ci, correspondant approximativement au bassin de l'ensemble Mississippi-Missouri, constituent un domaine encore plus vaste, étiré des Grands Lacs au golfe du Mexique, atteignant les Appalaches à l'E. Les Grandes Plaines ont un climat continental aux hivers de plus en plus froids vers le N. et aux étés parfois torrides, avec des précipitations croissant vers l'E. Des pluies abondantes (liées parfois au passage de cyclones), associées à des températures élevées, caractérisent le Sud-Est, subtropical. Rigueur de l'hiver et chaleur de l'été sont associées aussi au N.-E., dans le nord de la plaine atlantique, berceau de la nation et de la civilisation américaines.
La population. L'histoire et les conditions du milieu en expliquent la composition et la répartition, altérées toutefois par des évolutions récentes. Le Nord-Est demeure la région la plus densément habitée, mais la Californie est aujourd'hui l'État le plus peuplé. La population s'accroît rapidement dans les États du Sud et aussi du Sud-Ouest intérieur (Arizona, Nouveau-Mexique) au climat ensoleillé. Le fonds d'origine européenne (surtout britannique) domine toujours largement, mais les Noirs représentent environ 13 % de la population. Plus de la moitié d'entre eux sont encore concentrés dans le Sud historique. Les Hispano-Américains (17,8 %), pas toujours comptabilisés (nombreux Mexicains entrés illégalement), sont présents surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest (principal domaine des Indiens, 1,3 %). Les Asiatiques (5,7 %) sont concentrés dans l'Ouest. Globalement, la population s'accroît à un rythme d'environ 2,5 millions de personnes par an, qui a été réduit par la baisse sensible du taux de natalité (12 ‰). L'immigration a amené 50 millions de personnes entre 1820 et 1980, mais le quota annuel est aujourd'hui limité. Cependant, l'immigration clandestine reste importante. 82 % de la population vivent dans les agglomérations (aires métropolitaines), souvent démesurément étendues, comptant parfois de 3 à 15 millions d'habitants (New York, Philadelphie, Washington sur la côte atlantique ; Chicago et Détroit dans la région des Grands Lacs ; Los Angeles et San Francisco en Californie). Au total, plus de 200 villes dépassent 100 000 habitants.
L'économie. Elle demeure, et de loin, la plus puissante du monde, fondée sur un potentiel naturel considérable et surtout sur des disponibilités humaines, techniques et financières exceptionnelles.
Le sous-sol fournit en abondance du charbon et des hydrocarbures (pétrole et gaz naturel), de l'uranium, à la base d'une production d'électricité nucléaire supérieure à l'apport d'origine hydraulique et représentant environ 19 % de la production totale d'électricité. Toutefois, si les États-Unis assurent près de 25 % de la production énergétique mondiale, ils en absorbent encore plus. Le déficit est comblé par des importations de pétrole brut et raffiné, accessoirement de gaz naturel. Le sous-sol recèle aussi de nombreux minerais (fer, cuivre) et des phosphates.
Les disponibilités agricoles sont liées à l'étendue des surfaces, à la modernisation des exploitations de plus en plus concentrées (5 millions en 1950, 2 millions aujourd'hui et plus de 150 ha en moyenne). Le caractère spéculatif explique souvent (plus que les aléas climatiques) les variations des productions. Les États-Unis viennent au premier rang pour le maïs, le soja, au deuxième pour les agrumes, le coton et le tabac, au troisième pour le blé, le troupeau bovin, le bois et au quatrième pour la pêche. L'agriculture emploie moins de 2 % d'une population active d'environ 162 millions de personnes.
L'industrie et les mines en occupent environ 18 %. Sectoriellement et régionalement parfois en crise (comme l'agriculture d'ailleurs), souvent de plus en plus concurrencée sur les marchés extérieur et même intérieur (malgré un protectionnisme mal déguisé), l'industrie américaine demeure toutefois exceptionnellement puissante (tant par le volume des productions que par le poids des grandes entreprises aux intérêts mondiaux) et diversifiée. Les États-Unis sont devancés par le Japon dans la sidérurgie et la construction automobile. Mais ils conservent la suprématie pour la construction aéronautique, la métallurgie de l'aluminium et du cuivre, le raffinage du pétrole et, plus généralement (et plus nettement), pour la chimie (pharmacie, caoutchouc, plastiques, textiles synthétiques, etc.), l'ensemble des constructions électriques et électroniques, l'agroalimentaire, l'édition, etc.
La production est servie par un secteur tertiaire (totalisant 80 % de la population active) remarquablement développé, qu'il s'agisse des transports classiques (env. 85 000 km d'autoroutes, 350 000 km de voies ferrées, plus de 12 000 aéroports, un réseau exceptionnel d'oléoducs et de gazoducs) et des télécommunications, de l'infrastructure commerciale et surtout financière (15 000 banques, Bourse de Wall Street) et technologique (laboratoires et centres de recherches parfois liés aux puissantes universités).
Le commerce extérieur se caractérise par sa faible part dans le PIB (dont les exportations représentent 12 %). Cependant, les États-Unis, grâce au volume et à la valeur de la production, comptent parmi les tout premiers exportateurs mondiaux (produits agricoles et surtout industriels [très diversifiés]). Ils sont aussi, et plus nettement, le premier importateur, achetant notamment un complément d'hydrocarbures et de minerais (cobalt, nickel, chrome, bauxite) dont ils ne sont pas ou peu producteurs. Le solde de la balance commerciale est lourdement négatif et le déficit budgétaire s'est creusé. Après avoir connu à la fin des années 1990 une phase de croissance soutenue, l'économie américaine a enregistré un net ralentissement et a été frappée, à partir de 2007, par la crise financière des subprimes [crédits immobiliers à risque] qui s'est propagée dans l'économie nationale et mondiale. Toutefois, après une forte augmentation, le taux de chômage a été ramené en dessous de 5 % en 2016-2017.
HISTOIRE
La période coloniale. À partir du XVIe s., le territoire des États-Unis, occupé par des Amérindiens semi-nomades, est exploré par des navigateurs français, espagnols, puis anglais.
Dès le début du XVIIe s., les Anglais y émigrent en masse, fuyant les bouleversements politiques et religieux de leur pays. Quelques Allemands et Hollandais s'ajoutent à leur nombre. Ces immigrants s'installent sur la côte est du territoire.
1607-1733. La colonisation anglaise s'effectue alors que les Français poursuivent leur expansion le long du Mississippi, fondant la Louisiane. Création de treize colonies anglaises.
Le Sud (Virginie, Maryland), dominé par une société de planteurs propriétaires de grands domaines, exploités à l'aide d'esclaves noirs, s'oppose au Nord (Nouvelle-Angleterre), bourgeois et mercantile, d'un puritanisme rigoureux. Au XVIIIe s., colonies et métropole sont unies dans la lutte contre les Indiens et surtout contre la France.
1763. Le traité de Paris écarte définitivement la menace française et ouvre l'Ouest aux colons britanniques.
Cependant, les colonies supportent mal l'autorité de la Grande-Bretagne et se révoltent contre les monopoles commerciaux de la métropole.
1774. Le premier congrès continental se réunit à Philadelphie.
La rupture avec la Grande-Bretagne et l'indépendance
1775-1783. Cette attitude de résistance des colonies face à la Grande-Bretagne aboutit à la guerre de l'Indépendance, dont les buts sont précisés dans la Déclaration d'indépendance (4 juillet 1776). Les colonies sont commandées par Washington. À partir de 1778, elles obtiennent le soutien officiel de la France.
1783. La paix de Paris reconnaît l'existence de la République fédérée des États-Unis.
1787. Une Constitution fédérale, toujours en vigueur, est élaborée par la convention de Philadelphie.
George Washington devient le premier président des États-Unis (1789-1797).
Pendant la première moitié du XIXe s., l'expansion vers l'Ouest continue et de nombreux États sont créés à mesure que s'accroît le peuplement. Les États-Unis achètent la Louisiane à la France (1803) et la Floride aux Espagnols (1819).
1812-1815. Les Américains sortent victorieux de la seconde guerre de l'Indépendance, suscitée par la Grande- Bretagne.
1823. Le président Monroe réaffirme la volonté de neutralité des États-Unis et leur opposition à toute ingérence européenne dans le continent américain (doctrine de Monroe).
1846-1848. Guerre contre le Mexique. À l'issue du conflit, les États-Unis annexent le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie.
L'antagonisme entre le Sud, agricole et libre-échangiste, et le Nord, en voie d'industrialisation et protectionniste, est aggravé par le problème de l'esclavage, désavoué par le Nord.
La sécession du Sud et la reconstruction
1860. Le républicain Abraham Lincoln, résolument antiesclavagiste, est élu à la présidence. Les sudistes font alors sécession et se constituent en États confédérés d'Amérique.
1861-1865. Les nordistes l'emportent dans la guerre de Sécession.
1865-1871. Par trois amendements successifs, la Constitution fédérale abolit l'esclavage, impose la reconnaissance de la citoyenneté aux Noirs et interdit toute discrimination raciale.
En 1871, tous les États du Sud ont réintégré l'Union après avoir ratifié ces amendements.
L'essor des États-Unis. Le rapide développement des chemins de fer joue un rôle capital dans la construction de l'unité nationale et dans la progression vers l'Ouest.
1867. Les États-Unis achètent l'Alaska à la Russie.
1890. Le territoire américain est occupé de l'Atlantique au Pacifique.
Une forte immigration, venue de tous les pays d'Europe, favorise le redressement de l'économie ; la mécanisation et la monoculture sur de très grandes surfaces permettent l'essor de la production agricole et industrielle.
Les républicains, le plus souvent au pouvoir durant cette période, maintiennent un strict protectionnisme douanier et s'opposent aux monopoles des trusts, notamment sous la présidence de Theodore Roosevelt ; mais leur politique rencontre l'opposition des fermiers de l'Ouest, démocrates, cependant que les premières organisations syndicales apparaissent.
À partir de 1895, les États-Unis manifestent leur volonté d'expansion, notamment en Amérique latine : annexion de Porto Rico, des Philippines et de l'île de Guam à la suite d'une guerre avec l'Espagne (1898) ; implantation à Cuba (1901) et à Saint-Domingue (1905) ; acquisition de la zone du canal de Panama (1903).
1917. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne et fournissent dès lors une aide considérable aux Alliés. Mais le démocrate Theodore W. Wilson ne peut faire ratifier par le Sénat les traités de paix et l'entrée des États-Unis à la Société des Nations.
L'entre-deux-guerres. En faisant des États-Unis les fournisseurs des Alliés, la guerre a provoqué un développement rapide de la production industrielle et agricole et gonflé considérablement le stock d'or américain. Le niveau de vie s'accroît alors fortement, tandis que le gouvernement poursuit sa politique protectionniste, met un frein à l'immigration et instaure la prohibition (1919).
1929-1933. Grave crise économique.
Elle est due à la surproduction et à la spéculation et se répercute dans tous les États industriels du monde. De nombreuses faillites bancaires et industrielles entraînent un chômage catastrophique.
1933-1945. Le démocrate Franklin D. Roosevelt accède à la présidence. Sa politique de New Deal (« Nouvelle Donne ») s'efforce de porter remède par des mesures dirigistes aux maux de l'économie américaine. En politique extérieure, il pratique une politique de retrait en Amérique latine et soutient les démocraties européennes par la vente (1937) puis le prêt (1941) de matériel de guerre.
7 déc. 1941. L'attaque japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre des États-Unis.
1941-1945. Les États-Unis accomplissent un formidable effort économique et militaire.
Les États-Unis depuis 1945. Dès 1943, Roosevelt a multiplié les conférences pour organiser le monde de « l'après-guerre » et établir les fondements de l'Organisation des Nations unies (ONU), dont la Charte est signée en 1945. Après la victoire, les États-Unis doivent faire face à des difficultés intérieures dues au retour à une économie de temps de paix et à la démobilisation.
1945-1953. Début de la guerre froide avec l'URSS.
Sous la présidence du démocrate Truman, les États-Unis affirment leur volonté de s'opposer à l'expansion soviétique. En 1948, un plan d'aide économique à l'Europe (plan Marshall) est adopté, tandis que la signature du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) renforce l'alliance des puissances occidentales (1949).
1950-1953. Les États-Unis s'engagent dans la guerre de Corée, pour contrer l'expansion du communisme.
En même temps, ils renforcent leur politique d'alliance en Asie (pacte avec le Japon, 1951 ; création de l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est [OTASE], 1954).
Après la mort de Staline (1953), une relative détente s'instaure.
1953-1961. Le républicain Eisenhower pratique une politique énergique au Moyen-Orient.
1961-1963. L'administration démocrate du président Kennedy lutte contre la misère et la ségrégation raciale et inaugure une politique d'intervention armée au Viêt Nam.
Des programmes d'aide à certains États américains sont mis au point (1961). Après une période au cours de laquelle les crises se sont multipliées (Cuba, 1962), les relations des États-Unis avec l'URSS s'améliorent (accords de Moscou, 1963).
À partir de 1963, sous la présidence de L. Johnson (qui succède à Kennedy, assassiné), du républicain Richard Nixon (qui démissionne en 1974), puis de Gerald Ford, les États-Unis doivent faire face, à l'intérieur, à de multiples difficultés dues en particulier au problème noir (qui n'est pas résolu malgré la loi de 1964 affirmant l'égalité civique entre Noirs et Blancs) et à des problèmes économiques et sociaux.
1964. Les États-Unis s'engagent au Viêt Nam.
Après un renforcement de l'intervention militaire américaine en Indochine (bombardements systématiques sur le Viêt Nam du Nord, intensification des actions au Viêt Nam du Sud), la période est marquée par le rapprochement des États-Unis avec la Chine (voyage de Nixon à Pékin, 1972), par le désengagement des Américains au Viêt Nam (1973) et par la défaite de leurs alliés du Viêt Nam du Sud (1975).
1977-1981. Présidence du démocrate Jimmy Carter.
1979. Signature d'un traité de paix israélo-égyptien grâce à la médiation de Carter dans le conflit du Proche-Orient.
1981. Accession à la présidence du républicain Ronald Reagan (réélu triomphalement en 1984).
1985. La rencontre de Reagan et de Gorbatchev marque l'amorce d'une détente dans les relations avec l'URSS.
1987. La popularité du président Reagan est entamée par le scandale de l'« Irangate » (vente secrète d'armes à l'Iran) et par les difficultés économiques et financières. Reagan et Gorbatchev signent en décembre un accord sur l'élimination des missiles de moyenne portée en Europe.
1989-1993. Présidence du républicain George Bush. Il mène parallèlement une politique de fermeté (intervention au Panama [1989], engagement dans la guerre du Golfe [1991]) et d'ouverture (dialogue avec l'URSS).
1993. Accession à la présidence du démocrate Bill Clinton. Il développe une diplomatie active (Bosnie [accord de 1995], action en faveur de la paix au Moyen-Orient) et bénéficie d'une conjoncture économique très favorable.
2001. Le républicain George W. Bush, fils du président George Bush, succède à Bill Clinton (janv.). Le 11 sept., quatre avions de ligne américains sont détournés par des commandos-suicides ; deux sont précipités sur les tours jumelles du World Trade Center (qui s'effondrent), à New York, un – dont la cible demeure inconnue – s'écrase en Pennsylvanie, et un autre, sur le Pentagone, à Washington, faisant au total environ 3 000 victimes. Ces attaques, imputées à l'homme d'affaires saoudien O. Ben Laden, réfugié en Afghanistan, et à son réseau terroriste islamiste al-Qaida, provoquent un grave traumatisme dans le pays et dans le monde entier. Les États-Unis ripostent par une intervention militaire en Afghanistan.
2003. Les États-Unis, appuyés surtout par la Grande-Bretagne, mènent une offensive en Iraq, qui conduit à l'effondrement du régime de Saddam Husayn.
2004. Réélection de George W. Bush.
2005. Un ouragan dévaste la Louisiane.
À partir de 2007. Les États-Unis sont confrontés à une crise financière, économique et sociale majeure.
2009. Le démocrate Barack Obama est le premier Afro-Américain à accéder à la présidence. Les républicains l'emportent à la Chambre des représentants en 2012, mais la réforme de l'assurance-maladie est validée par la Cour suprême et le président est réélu.
2017. Le républicain et homme d'affaires Donald Trump devient président après avoir été élu face à la démocrate Hillary Clinton avec un programme protectionniste et populiste.
2021. Le démocrate Joe Biden accède à la tête de l'État, élu face au président sortant, D. Trump.
2024. D. Trump est élu une nouvelle fois président.